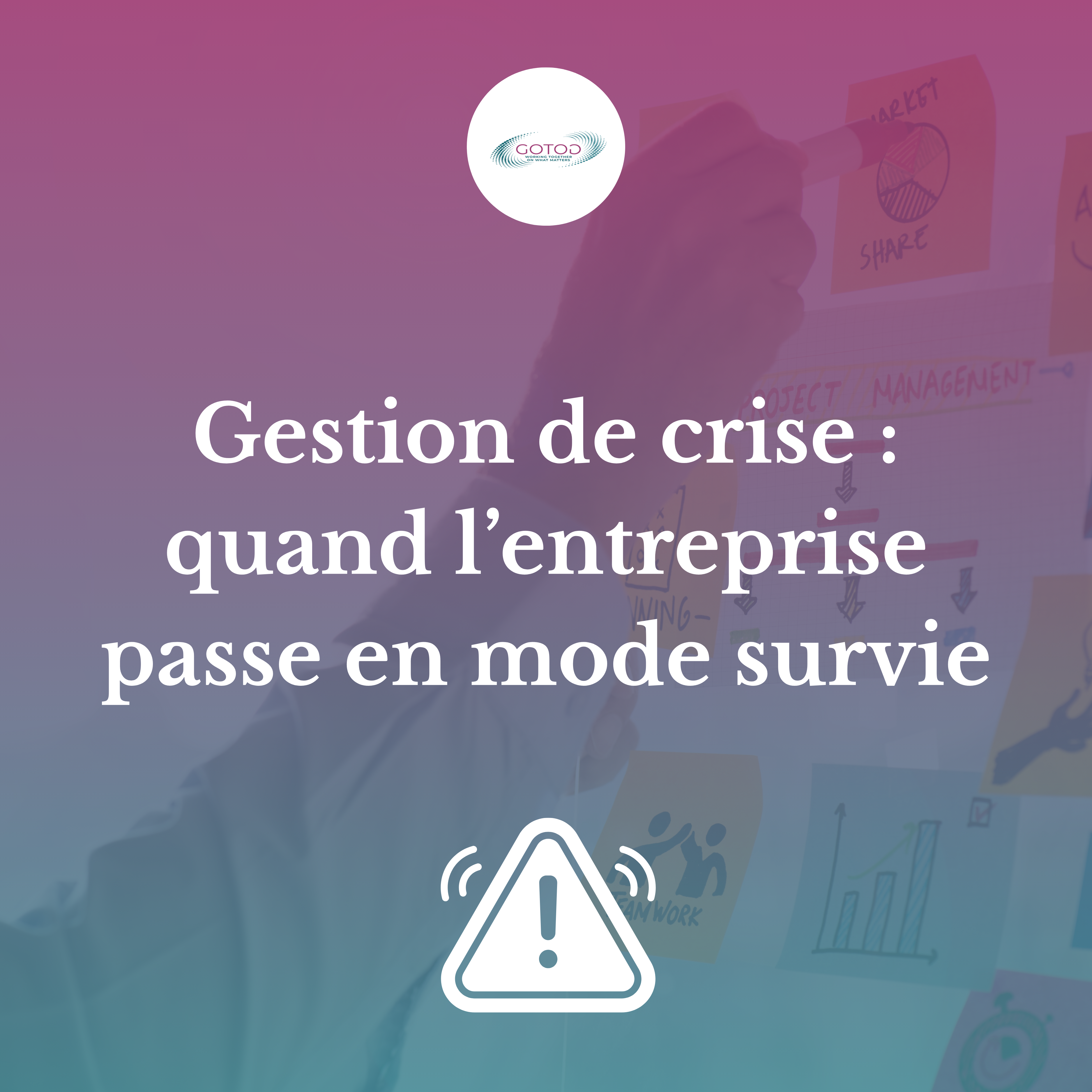
Une crise ne prévient jamais
Que ce soit une panne, un arrêt de la production, ou une cyberattaque… en une seconde, tout peut basculer.
Seulement voilà, le mode crise ne se déclenche pas seulement lors d’évènements à fort impact pour l’entreprise. Il s’active aussi lors d’impacts limitées comme un problème de performance d’équipe, un outil qui bloque, un retard à fort enjeu. Trop souvent hélas, il s’active aussi sans réel impact. Par exemple, un chef sous pression qui, par peur pour sa réputation ou son poste, réagit comme si tout brûlait. Ce qui déclenche le mode crise est souvent lié au stress.
Regardons de plus prêt en quoi consiste le mode crise, ses correspondances avec le mode survie et enfin les conséquences d’un mode crise non justifié.
-
1. Les caractéristiques du mode crise
Le temps, paramètre majeur :
-
En mode crise, une seule question compte : “Combien de temps avant qu’on rétablisse au moins un service minimum ?”.
Chaque minute perdue coûte cher, c’est pourquoi la règle est simple : agir au plus vite. - Le mode dictature
-
En mode crise, il y a le temps de la concertation et le temps de la décision. Décider permet la mise en mouvement vers la restauration du service. Lorsque qu’une décision est prise alors chacun l’exécute. Le coordinateur global de la crise dirige, tous les autres obéissent. C’est comme dans un orchestre avec un chef très directif et des musiciens qui suivent sans improviser. C’est efficace… mais c’est aussi épuisant et les collaborateurs peuvent se sentir rabaissés à de simples exécutants, quel que soit leur rôle habituel.
-
Le retour à la normale
Lorsque la crise est terminée, il est essentiel de rétablir un fonctionnement normal. Remettre de l’ordre dans les process contournés, redonner l’autonomie aux rôles officiels et, bien sûr, tirer les leçons pour les prochaines fois. Dans le cas contraire, l’entreprise risque de s’épuiser dans une urgence permanente.
- 2. Le mode survie
Ecarter le danger, paramètre majeur
Le mode survie, c’est d’abord une logique individuelle : écarter le danger immédiat. On ne cherche pas la meilleure option, on prend la plus rapide.
- Décisions centrées sur l’individu
Contrairement au mode crise, qui est organisé, le mode survie est un réflexe individuel. Les décisions prisent sont décorrélées du groupe.
- L’épuisement est la contrepartie
-
Mais une fois le danger écarté, vient la fatigue, voire l’épuisement. Comme après une course effrénée, le repos est nécessaire avant de retourner au mode normal.
3. Le stress
Les causes du stress
Le stress est un état d’inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. La peur de mal faire, un risque de dégrader sa réputation, la crainte de perdre son poste, la transgression de ses règles éthiques, etc… sont des terreaux favorables au ressenti du stress.
La bascule en mode survie
Sous stress intense ou prolongé, le cerveau bascule en mode survie : champ de vision réduit, autorité brutale, décisions rapides. Comme il s’agit d’un déclenchement individuel et sans réelle « crise », il est fréquent que les collaborateurs ne comprennent pas.
Les conséquences pour l’enourage
Ne trouvant pas de sens au mode survie de leur responsable, les collaborateurs obéissent à contrecœur, les tensions interpersonnelles montent, les relations se détériorent et la confiance s’effrite. Au lieu de renforcer le collectif, le stress favorise un retour au chacun pour soi.
Retour au mode normal
Lorsque ce qui provoque l’inquiétude est écarté, le chef sort du mode survie. Malheureusement, il est rare qu’il pense à restaurer le collectif dégradé par sa gestion sous stress. Les conséquences risquent de se faire sentir bien après le retour en mode normal du chef. L’impact pour les collaborateurs est significatif et beaucoup d’ouvrages en parlent. J’en resterai donc sur la dégradation du travail collaboratif.
Et cela coûte cher aux entreprises.
Alors que faire ?
4. Faire appel au coaching pour endiguer les passages en mode survie
Mieux se connaître
-
Le coaching aide à prendre conscience de ce qui nous fait entrer en mode survie. Un travail de coaching aide à détecter plus tôt les dérives et corriger le tir avant qu’il n’y ait du dégât
Construire des relations interpersonnelles solides
-
Grâce à des actions concrètes visant à renforcer les liens, le collectif devient acteur de sa sécurité, limitant ainsi les risques de stress. De plus, en prenant soin les uns des autres et en se disant les choses, chacun peut bénéficier, non seulement de la protection de l’autre mais aussi de son soutien. « Je le fais pour toi car je suis sûr que tu le ferais pour moi ». Cela demande du travail et le coaching peut accélérer la mise en place de ce type d’ambiance collective.
Entretenir/réparer les relations
Nul n’est parfait et la vraie vie apporte ses imperfections. Un travail de coaching collectif aide à restaurer des relations saines et à réparer ce qui doit l’être. Les relations, ont besoin de maintenance préventives pour rester performantes et saines. L’instaurations de pratiques régulières augmente considérablement la sensation d’appartenance et de sécurité collective.
- Conclusion
-
Le mode survie se déclenche bien souvent sans en être conscient. L’effet prolongé risque de dégrader significativement la performance d’un collectif. Se donner un espace pour prendre du recul et faire évoluer ses pratiques individuelles et collectives est un bon moyen d’améliorer significativement la productivité et aussi la qualité de vie au travail.
-
Les professionnels du coaching sont les acteurs accompagnant ces améliorations.
👉 Et vous ?
Prêt à travailler avec un coach pour donner un second souffle à votre collectif ?
Contactez-moi pour un accompagnement personnalisé. Ensemble, redonnons à votre posture la souplesse et la robustesse qu’elle mérite
💬 Je suis Jean-Marc, coach professionnel certifié. J’accompagne les individus, les équipes et les organisations en quête d’un second souffle professionnel.
Travaillons ensemble sur ce qui compte.

